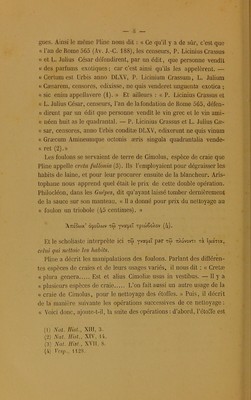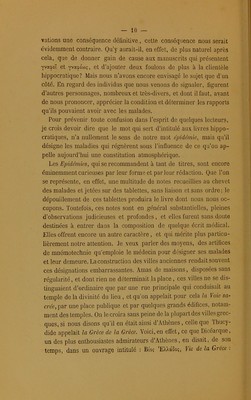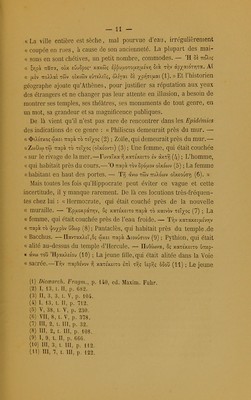Gnathon et Scymnus, deux artistes peintres découverts dans les Épidémies d'Hippocrate : à ce sujet, classification des personnages qui figurent dans les Épidémies et explication de la légende d'Hippocrate / par J.-P. Rossignol.
- Rossignol, Jean-Pierre, 1804-1893.
- Date:
- 1858
Licence: Public Domain Mark
Credit: Gnathon et Scymnus, deux artistes peintres découverts dans les Épidémies d'Hippocrate : à ce sujet, classification des personnages qui figurent dans les Épidémies et explication de la légende d'Hippocrate / par J.-P. Rossignol. Source: Wellcome Collection.
Provider: This material has been provided by The Royal College of Surgeons of England. The original may be consulted at The Royal College of Surgeons of England.
12/52 (page 12)
![« homme, qui était alité sur la place des Menteurs.—To pipdxiov, â « xarsxeiTO £~1 tj/suoéojv àyopTj (1). » Un des signes de reconnaissance que le grand docteur emploie aussi très-fréquemment, c’est le nom de certains personnages qui se trouvaient à quelque titre en rapport avec ses malades. Tantôt les malades sont les esclaves de ces personnages, et cela est dit ex- pressément; nous avons déjà cité plus haut un assez grand nombre d’exemples. Tantôt les malades sont logés près de ces personnages ; ainsi : « La femme, qui demeurait à côté de la propriété d’Aristion. « — ‘H -xapà Ta AptfTTtiovoç (oîxsouca) (2) ; Silène habitait sur la « Plate-Forme, près de la propriété d’Evalcidas. — 2àXr,vbç wxei ItI « tou nXxTaij.wvoç, Xrjcjtûv tôIv EuaXxîSou (3); une femme, à Thasos, « habitait près de la propriété de Pylade, dans la plaine. — ’Ev « 0dow, yuvy) wxet 7iXy]tftov twv (4) ITuXdoou, etu tou As tou (5). » D’autres fois, et le cas se présente assez souvent, il est dit des ma- lades qu’ils sont couchés, alités chez les personnages en question ; ainsi : « Héraclide, qui était couché chez Aristocyde. — 'HpaxXet&iç, > <i xaTÉxstTo Tapa ’AptGToxuoet (6); Bion, couché chez Silène.—Btom, « tco 7tapoc I-iXrivôv (7) xaTax£ty.évw (8) ; Phanocrite, qui était couché (1) III, 8, t. III, p. 86. (2) III, 7, t. III, p. 52. (3) I, 2, t. II, p. 684. (4) Je lis -üv donné par les manuscrits, et qui est la vraie leçon. C’est à tort que M. Littré a conservé tcü, et traduit : « Elle demeurait auprès « de Pylade. » (5) III, H, t. III, p. 134. (6) I, 8, t. II, p. 644. (7) ïlapà SlXyivov. — Deux manuscrits et le texte de Galien ont donné XtXnvû; mais il faut laisser l’accusatif. La même phrase revient plus bas (p. 650), et présente cette fois ce cas sans variante : « BLm, 8; xarsxEiTo « Tapa XcXyivov. » Tlapà s’employait aussi avec 1 accusatif, dans le sens de chez. Un grammairien des Anecdota de Bekker remarque que le poète comique Alexis avait dit : Tap’ ÿiu.Z; oUêl, au lieu de Tap’ riplv : « nap’ r,u.à; « cîxet* dtvTt toü Tap’ ■np.Tv. AXs^tç ^iXaO*/ivatti) (p. 111). » Priscien observe que les Attiques disaient Tapa ai, au lieu de Tapa aot, comme les Latins, apud te: « Attici Tapa ae pro Tapa aot, quo modo et nos, apud te (p. 1198, « ed. Putsch.). » Hippocrate offre encore d’autres exemples de cette pré- position régissant le môme cas et dans le même sens.](https://iiif.wellcomecollection.org/image/b22447623_0014.jp2/full/800%2C/0/default.jpg)