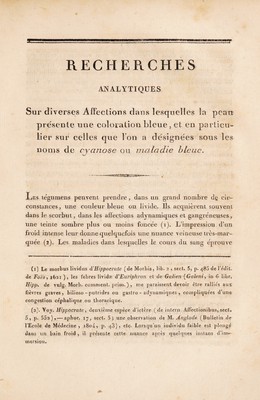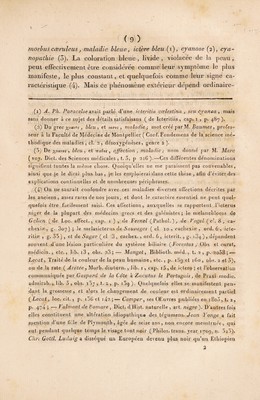Recherches analytiques sur diverses affections dans lesquelles la peau présente une coloration bleue : et en particulier sur celles que l'on a désignées sous les noms de cyanose ou maladie bleue / Par Elie Gintrac.
- Gintrac, E. (Elie), 1791-1877.
- Date:
- 1814
Licence: Public Domain Mark
Credit: Recherches analytiques sur diverses affections dans lesquelles la peau présente une coloration bleue : et en particulier sur celles que l'on a désignées sous les noms de cyanose ou maladie bleue / Par Elie Gintrac. Source: Wellcome Collection.
9/102 (page 9)
![morhus cœruleus J maladie, bleue, ictere bleu (i), cyanose (2), cya^ nopathie (o). La coloration bleue, livide, violacée de la peau, peut effectivement être considérée comme leur symptôme le plus manifeste, le plus constant, et quelquefois comme leur signe ca¬ ractéristique (4). Mais ce pliénomène extérieur dépend ordinaire- 1^—W——P————i—I—ÉWWi—— —l^ (1) A, Ph. Pai'acelse ava.it ^Siïlé d’une icteritia cœlestina , seii cjanea ^ mais sans donner à ce sujet des details satisfaisans ( de Icteritiis, cap. i , p. 487). (2) Du grec J bleu-) et vccroç ^ maladie; mot créé par M. , profes¬ seur à la Faculté de Médecine de Montpellier ( Conf. Foiidemens de la science mé¬ thodique des maladies , cl. 2, désoxygénèses, genre 2). ^ (5j De x'^c&voç ^ bleu ^ et , affection, maladie ; nom donné par M. Marc ( voj. Dicl. des Sciences médicales , t. 3, p 216).—Ces dififérentes dénominations signifient toutes la même chose. Quoiqu’elles ne me paraissent pas convenables, ainsi que je le dirai plus bas, je les emploierai dans cette thèse ^ afin d’éviter des explications continuelles et de nombreuses périphrases. ; (4) On ne saurait confondre avec ces maladies diverses affections décrites par les anciens, assez rares de nos jours^ et dont le caractère essentiel ne peut quel¬ quefois être facilement saisi. Ces affections, auxquelles se rapportent l’ictcrus niger de la plupart des médecins grecs et des galénistes ; le raelanchloros de Galien (de Loc. affect., cap. 1 ) , de Fernel (Pathol. de Vogel ( cL 8 ^ ca- chexiæ, g. 807) ; le melasiclerus de (cl. 10, cachexiæ , ord. 61, icîc- riliæ , g. 35 ), et de( cl 3, cachex., ord. 6, icterit. , g. 184 ), dépendent souvent d’une lésion particulière du système biliaire fforesius, Obs et curât, médicin. , etc., lib. i3, obs. 285— Mange t ■, Bibiiolh. méd,, t. 2 , p. 2o38 ; — Lecat-, Traité de la couleur de la peau humaine, etc., p. i5g et 160 , obs. 2 et 3), ou de la rate (^Arétée^ Morb. diuturn., lib. cap. i5,de ictero; et l’observation communiquée par Gaspard de la Cote a Zacutus le Portugais, de Praxi medio. admirab.,, lib. 3, obs. 15^ , t. 2 , p. ]5q). Quelquefois elles se manifestent peu- • dant la grossesse,, et alors le changement de couleur est ordinairement partiel (^Lecat, loc. cit. , p. i5G et j42;— Camper.^ ses OEuvres publiées en i8o3, t. 2, p. 474 5 '— Valmont de Bomare , Dicl. d Hist. naturelle , art. nègre ). D’autres fois elles constituent une altération idiopathique des tégumens. Jean Yonge a fait niention d’une fille de Plymputh, âgée de seize ans, non encore menstruée, cjui eut pendant c|uelque temps le,visage tout noir (Philos, trans. year 1709, n. 325). Chr. Gottl. Ludmg a disséqué un Européen devenu plus noir qu’un Ethiopien 2](https://iiif.wellcomecollection.org/image/b30391027_0009.jp2/full/800%2C/0/default.jpg)