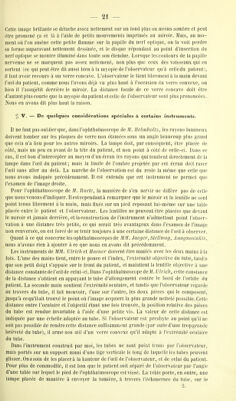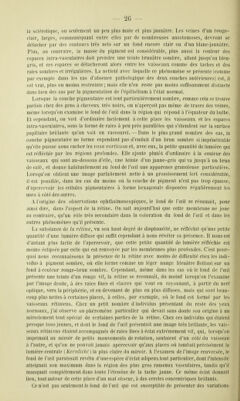De l'examen de l'oeil au moyen de l'ophthalmoscope / von Richard Liebreich.
- Liebreich, Richard, 1830-1917.
- Date:
- 1857
Licence: Public Domain Mark
Credit: De l'examen de l'oeil au moyen de l'ophthalmoscope / von Richard Liebreich. Source: Wellcome Collection.
Provider: This material has been provided by UCL Library Services. The original may be consulted at UCL (University College London)
28/70 (page 24)
![d'une utilité inappréciable; cependant, cet examen peut être singulièrement facilité par un résumé des connaissances acquises jusqu'à ce jour, et nous pensons, en conséquence, devoir nous y arrêter quelques instants. Supposons que nous observions un œil normal tourné légèrement en dedans (d'environ 15 à 20°), de la manière déjà indiquée plus haut. Nous apercevons alors au centre du champ visuel un petit disque circulaire blanc et brillant, du milieu duquel émergent les vaisseaux centraux delà rétine. Ce disque n'est rien autre que la papille du nerf optique. Les vaisseaux se ramifient et se répandent dans toutes les directions sur un fond plus ou moins rouge. Avant tout, il s'agit de savoir cequec'est que ce fond rouge. Est-ce la rétine? est-ce la choroïde, ou seulement une couche de cette dernière membrane? Ces questions ont reçu les solutions les plus diverses. Pour ce qui nous concerne, nous pensons que le véritable étal des choses est celui que nous allons décrire : Le nerf optique et la rétine, la choroïde et la sclérotique ont leur part dans la pro- duction des images que présente le fond de Vœil. Les rayons lumineux qui tombent sur la couche antérieure de ces membranes sont en partie absorbés, en partie réfléchis. Les rayons qui ont traversé la première couche sont, à leur tour, en partie renvoyés par la seconde et en partie admis par elle pour venir en frapper une troisième, el ainsi de suite. Mais il est clair que les couches qui sont les plus voisines de l'observateur et qui sont traversées pour la seconde fois par ces rayons que leur renvoient les couches plus profondes, il est clair, d:sons-nous, que ces couches doivent exercer une influence essentielle sur la couleur el la clarté de la lumière réfléchie par les différentes membranes. Nous observons le fond de l'œil pour ainsi dire à la lumière incidente et, en même temps, par transparence. La membrane qui, dans l'état normal, réiléciiit la plus grande quantité de lumière est la sclérotique, a, en particulier, sa face antérieure. La plus grande partie des rayons lumineux qui tombent sur celte dernière sont réfléchis par elle et viennent illuminer la choroïde el la rétine; il n'y en a qu'une faible partie qui pénètre jusque dans la sclérotique elle-même. Dans des conditions favorables, nous pourrons encore percevoir parfois une partie de ces rayons renvoyés par la substance même de la sclérotique, c'est-à-dire que nous pourrons la voir jusqu'à la surface postérieure de cette membrane. Je me suis assuré de ce fait pour la première fois sur une jeune fille albinos chez laquelle je pus pour- suivre, dans son parcours au travers de la sclérotique, un vaisseau de la choroïde qui traversait obliquement la première. Je vis par conséquent, la substance de la sclérotique devant le vaisseau, lequel formait pour ainsi dire le fond du tableau. Le vaisseau qui, dans le reste de son parcours, présentait une couleur d'un rouge intense, offrait à cette place une coloration notablement affaiblie par le tissu sclérotical qui le recouvrait. Ce fait peut s'observer constamment chez les lapins blancs, dont la sclérotique délicate en facilite la constatation bien plus encore que l'albinisme le plus parfait d'un œil humain. Les taches grisâtres que nous trouvons normalement sur le fond de l'œil d'un lapin blanc (1) ont leur siège, non pas dans la réline, mais dans la sclérotique, et ne sont pas autre chose que les points où les vaisseaux ciliaires courts traversent cette membrane. Lorsqu'on les observe avec soin, en particulier lorsque, tournant le manche du spéculum, on les éclaire alternativement au moyen de la lumière centrale directe et au moyen de la demi-lumière {IlaWlichi), la lumière centrale étant tournée de côté, on acquiert bientôt la conviction <\ue toutes ces taches se laissent poursuivre comme une continuation des troncs les plus forts des vaisseaux choroïdiens. Lorsqu'on extirpe tout simplement un bulbe oculaire el qu'on examine aussitôt le fond de l'œil à l'aide de l'ophthalmoscope, on ne trouve plus aucune trace de ces taches, au moins dans les cas où le sang des vaisseaux de la choroïde s'est complètement échappé. Mais si, avant de procéder à l'extirpation, on {D Van TrigI on parle de la manière suivaiile : « Çà et là Ton remarque entre eux (c'esl-à dire entre ]cs vasa vorticosa) une tache d'un gris mal, qui |)araît èire située dans la réline. Cependant comme ces taches se présentent presque conslammenl, il n'est guère possible de les considérer comme palliologiques. »](https://iiif.wellcomecollection.org/image/b21636904_0028.jp2/full/800%2C/0/default.jpg)