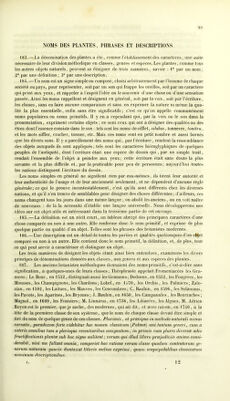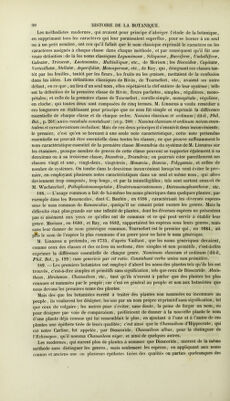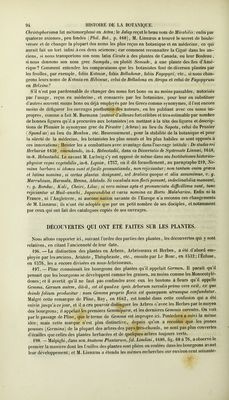Histoire de la botanique et plan des familles naturelles des plantes.
- Adanson, Michel, 1727-1806.
- Date:
- 1864
Licence: Public Domain Mark
Credit: Histoire de la botanique et plan des familles naturelles des plantes. Source: Wellcome Collection.
109/330 (page 89)
![NOMS DES PLANTES, PHRASES ET DESCRIPTIONS. 183. — La dénomination des plantes a été, comme l’établissement des caractères, une suite nécessaire de leur division méthodique en classes, genres et espèces. Les plantes, comme tous les autres objets naturels, peuvent se désigner de trois manières, savoir : 1® par un nom ; 2® par une définition ; 3® par une description. 184. —Un nom est un signe simple ou composé, choisi arbitrairement par l’homme de chaque société ou pays, pour représenter, soit par un son qui frappe les oreilles, soit par un caractère qui peint aux yeux, et rappeler à l’esprit l’idée ou le souvenir d’une chose ou d’une sensation passée. Ainsi les noms rappellent et désignent en général, soit par la voix, soit par l’écriture, les choses, sans en faire aucune comparaison et sans en exprimer la nature ni même la qua- lité la plus essentielle, enfin sans être significatifs; c’est ce qu’on appelle communément noms populaires ou noms primitifs. Il y en a cependant qui, par la voix ou le son dans la prononciation, expriment certains objets ; ce sont ceux qui ont à désigner des qualités ou des êtres dont l’essence consiste dans le son ; tels sont les noms de sifflet, silnius, tonnerre, lunitru, et les mots siffler, cracher, tonner, etc. Mais ces noms sont en petit nombre et aussi bornés que les divers sons. Il y a pareillement des noms qui, par l’écriture , rendent la ressemblance des objets auxquels ils sont appliqués; tels sont les caractères hiéroglyphiques de quelques peuples de l’antiquité, dont l’écriture était une espèce de dessin qui , par un simple trait, rendait l’ensemble de l’objet à peindre aux yeux; cette écriture était sans doute la plus savante et la plus difficile et, par là praticable pour peu de personnes; aujourd’hui toutes les nations distinguent l'écriture du dessin. Les noms simples en général ne signifient rien par eux-mêmes, ils tirent leur autorité et leur authenticité de l’usage et de leur ancienneté seulement, et ne dépendent d’aucune règle générale; ce qui le prouve incontestablement, c’est qu’ils sont différents chez les diverses nations, et qu’il s’en trouve de semblables pour désigner des choses différentes; d’ailleurs, ces noms changent tous les jours dans une même langue ; on abolit les anciens, on en voit naître de nouveaux ; de là la nécessité d’établir une langue universelh. Nous développerons nos idées sur cet objet utile et intéressant dans la troisième partie de cet ouvrage. 185. — La définition est un récit court, un tableau abrégé des [uincipaux caractères d’une chose comparée ou non à une autre. Elle renferme donc le nom primitif, et exprime de plus quelque partie ou qualité d’un objet. Telles sont les phrases des botanistes modernes. 186. —Une description est un détail de toutes les parties et qualités quelconques d’un objet comparé ou non à un autre. Elle contient donc le nom primitif, la définition, e(, de plus, tout ce qui peut servir à caractériser et distinguer un objet. Les trois manières de désigneras objets étant ainsi bien entendues, examinons les divers principes de dénominations données aux classes, aux genres et aux espèces des plantes. 187. Les anciens botanistes méthodiques donnaient des noms primitifs, c’est-à-dire sans signification, à quelques-unes de leurs classes; Théophraste appelait Fromentacées les Gra- mens ; Le Bouc, en 1532, distinguait aussi les Grarnens-; Dodoens, en 1552, les Fougères, les Mousses, les Champignons, les Chardons; Lobel, en 1570, les Orchis, les Palmiers; Zahi- zian, en 1592, les Laitues, les Mauves, les Concombres; C. Bauhin, en 1596, les Solanums, les Pavots, les Aparines, les Bryones; J. Bauhin, en 1650, les Campanules, les Bourraches ; Magnol, en 1689, les Fraisiers; M. Linnæus, en 1738, les Liiiacées, les Algues. M. Adrien Royenestle premier, que je sache, des modernes, qui ait dit, et avec rai.-on, en 1740, à la tête de la première classe de son système, que le nom de chaque classe devait être simple et tiré du nom de quelque genre de ces classes. Plurimis, al prœcipue in melhodo naturali minus versatis, paradoxon forte videhüur hoc nomen classicum [Palmæ] uni tantum ijeneri, cum a veteris omnibus tum a plerisque recentioribus assignaium ; in primis cum plures diversœ adeo fructificationis plantœ sub hoc signo militent; verum qui illud libero prœjudiciis animo consi- derabit, nisi me fallant ornnia, comperiet hac ratione verum classe quadarn contenterum ge- nerum naiuram paucis dunlaxat lilleris melius exprimi, quarn scsquipedalibus classicorum nominuni descripiionibus. 1. 12](https://iiif.wellcomecollection.org/image/b24863890_0109.jp2/full/800%2C/0/default.jpg)