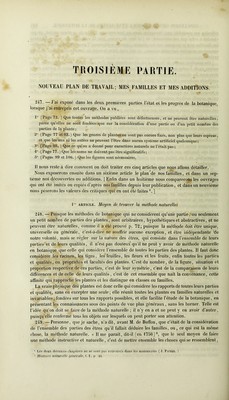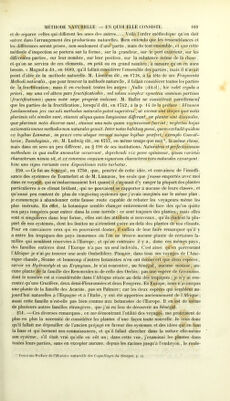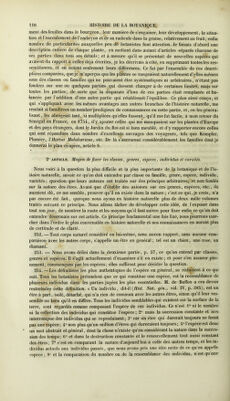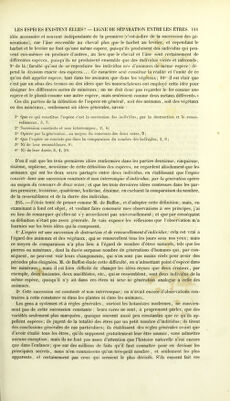Histoire de la botanique et plan des familles naturelles des plantes.
- Adanson, Michel, 1727-1806.
- Date:
- 1864
Licence: Public Domain Mark
Credit: Histoire de la botanique et plan des familles naturelles des plantes. Source: Wellcome Collection.
132/330 (page 112)
![I éllexions, ils n’eussent vraisemblablement pas adopte cet axiome trop général ; « Les indiv idus meurent, mais l’espèce ne meurt pas; » car nombre de coquilles fossiles sont des espèces anciennes mortes pour nous; et il parait que le nombre des espèces augmente dans certains pays, tandis qu’il diminue dans d’autres [sans qu’on ait des preuves qu’il s’en forme de nou- velles qui remplacent les premières]. 3 L’espèce consiste dans la génération par le concours de deux sexes. J’accorderai volon- tiers que les espèces sont clairement distinguées dans les animaux et les végétaux, qui se reproduisent par la fécondation de deux individus semblables ou non; mais, en admettant ce troisième principe de la définition de l’espèce en général, et qui se borne aux animaux et aux végétaux plus composés, appelés improprement pour cette raison plus parfaits, on deman- dera que deviendront tant d’autres es'pèces moins composées et peut-être plus parfaites, quoi- qu’on leur donne communément le nom d’imparfaites, dont chaque individu reproduit son semblable par la génération , sans aucun acte extérieur de copulation ou de fécondation, et que j’appelle pour cette raison Aphrodites, tels que quelques pucerons, les conques, la plu- part des vers sans sexe et certaines plantes? Que deviendront les Aphrodites qui reproduisent leurs semblables, non par la génération, mais par la section d’une partie de leur corps, c’est-à-dire par bouture, comme les Polypes et la plupart des plantes? Seront-ce des individus? Mais des individus dont la figure est constante, et dont plusieurs se ressemblent et se multi- plient par succession constante , sont réputés former une espèce. Quand on accorderait encore que les Aphrodites qui se multiplient, soit par la voie de génération, soit par la voie de section ou de bouture, constituent des espèces, que seront encore ces espèces d’animaux ou végétaux, Aphrodites ou non, que l’on greffe, et dont on fait un seul être de deux, de trois, de vingt? Que seront au contraire les individus que l’on partage, et du corps desquels on fait, en le fendant, deux, trois ou vingt corps sur le même pied, et qui multiplieront chacun de leur côté? Sera-ce un seul individu, ou deux, trois, vingt individus? Voilà bien des difficultés et des irrégularités qui semblent prouver que les trois proposi- tions contenues dans la définition de l’espèce, par M. de Buffon, ne suffisent pas pour la rendre générale ou applicable à tous les êtres, pas même à tous les animaux ou à tous les végétaux , et qu’elle exclue entièrement les minéraux ; de sorte qu’elle paraît indiquer qu’il n’existe, à proprement parler, point d’espèces dans la nature , mais seulement des individus, comme le dit M. de Buffon {Hist. Nat. gèn., t. I, p. 38): «Il n’existe réellement dans la « nature que des individus, et les genres, les ordres et les classes n’existent que dans notre « imagination. » Et ailleurs, t. IV, p. 385) : « La nature ne connaît pas ces prétendues familles, « et ne contient que des individus. » En effet, s’il est vrai, comme l’indiquent les exemples cités ci-dessus, que l’espèce n’est bien caractérisée que lorsque la nature a partagé les deux sexes et le moyen dè la multiplication entre deux individus, il s’ensuivra nécessairement que les classes et les genres n’existent pas plus que les espèces, et qu’il n’y a réellement dans la nature que des individus qui se suivent, en se fondant, pour ainsi dire, les uns dans les autres, par le moyen des variétés , et en passant insensiblement des minéraux dans les végé- taux et les animaux ; de sorte qu’ils paraissent ne former que des parties intégrantes d’un seul tout; d’où l’on conclura que la nature n’a pas établi cette division qu’on suppose des trois règnes, non plus que les classes, les genres et les espèces, qui n’existent que dans notre imagination. 256. — Mais, quoique les individus paraissent devoir être intimement liés lesunsaux autres, de manière que leur ensemble ne forme qu’un seul tout, un seul être universel, dont ils seraient les parties, cependant cette idée de l’unité disparaîtra dès qu’on réfléchira sur les propriétés des êtres. L’univers a pu n’être pas divisé, et il ne l’est peut-être pas relativement à la na- ture ou à l’Être suprême; mais il est réellement divisé en parties relativement à nous, et cela suffît. Nous voyons que chacune de ses parties, que chacun des êtres qui le composent est isolé, et vit séparément de ses semblables et de ses dissemblables; que ceux qui se ressem- blent le plus diffèrent inégalement et plus ou moins entre eux par la figure, la situation, la proportion, le nombre de leurs parties, par les mœurs, les inclinations, les facultés, etc.; enfin , que les plus composés ont entre eux un plus grand nombre de différences que les plus simples. C’est dans ces différences, nuancées plus ou moins sensiblement, et dont l’ensemble est plus marqué , que consistent les vides ou distances qu’on remarque entre les êtres, ces](https://iiif.wellcomecollection.org/image/b24863890_0132.jp2/full/800%2C/0/default.jpg)