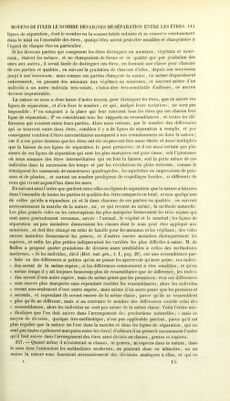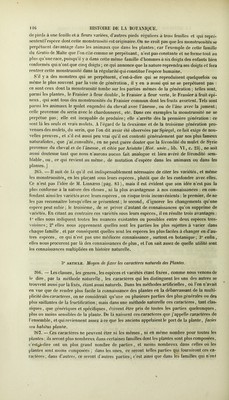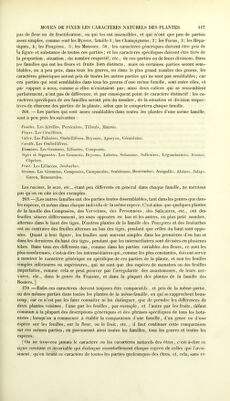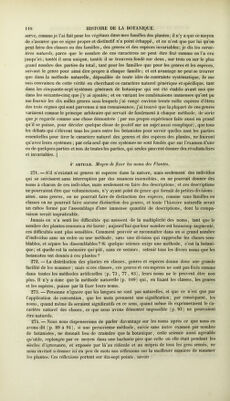Histoire de la botanique et plan des familles naturelles des plantes.
- Adanson, Michel, 1727-1806.
- Date:
- 1864
Licence: Public Domain Mark
Credit: Histoire de la botanique et plan des familles naturelles des plantes. Source: Wellcome Collection.
134/330 (page 114)
![l)Oiirraient prendre le nom dans une méthode naturelle; et il n’est pas douteux que s’il existe une méthode naturelle, c’est celle qui est fondée sur ces deux principes , savoir ; qu’il faut suivre ces lignes de séparation et dans l’ordre qu’elles gardent entre elles, et dans l’en- semble de toutes les parties et qualités où ces lignes se rencontrent ; quand même il n’y aurait pas d’espèce fixe, cette métiiode, ainsi entendue, n’en serait pas moins naturelle ni moins certaine, par la raison ci-dessus expliquée (pag. M3), que nous saurions par le nombre des différences qui se trouvent entre deux êtres ou espèces voisines, combien il nous manque d’êtres intermédiaires. 238.— La méthode naturelle n’est donc pas une chimère comme le prétendent quelques au- teurs, qui confondent sans doute avec elle la méthode parfaite; et si pour être parfaite elle exige la connaissance d’un plus grand nombre d’êtres que nous n’en possédons, elle n’exige pas comme on le croit, la connaissance de tous [il suffit qu’elle rapproche, suivant le plan expli- qué ci-dessus, toutes les espèces connues]. On ne réussira pas tant qu’on cherchera à désunir les êtres, en ne considérant qu’une ou un petit nombre de parties; mais elle ne sera pas chi- mérique dès qu’on voudra les unir, en saisissant dans toutes leurs parties tous les rapports possibles, comme il parait suffisamment prouvé. Nous disons plus, c’est que s’il existe des classes, des genres et des espèces, ce ne peut être que dans la méthode naturelle; elle seule peut les fixer, et par conséquent donner cette perfection que l’on chérche dans la botanique et l’histoire naturelle. Enfin, nous posons comme un fait que tant qu’on n’aura pas trouvé la méthode naturelle, on ne saura pas précisément ce qu’on peut et doit appeler classe, genre et espèce; quelles sont les parties communes aux unes, refusées aux autres; celles qu’il faut observer plus particulièrement dans chaque être pour en tirer les caractères classiques , gé- nériques et spécifiques, et ce qu’il en faut négliger, comme des minuties ou caractères super- flus qui surchargent inutilement la mémoire : car quoiqu’il n’y ait, pour ainsi dire, pas un objet dans la nature qui ne puisse seul occuper un homme pendant toute sa vie, sans qu’il en épuise toutes les propriétés, il ne s’ensuit pas que nous devions pour cela épuiser toutes les connaissances sur chaque objet. C’est faute d’avoir trouvé cette méthode naturelle que les genres n’ont pas encore été fixés, et qu’ils varient plus ou moins dans chaque méthode ; voilà la solution de cette question que font tous les jours les étudiants en botanique ; Pourquoi chaque auteur d’un nouveau système fait-il des classes, des genres et des espèces ou des phrases spécifiques, différentes de celles de ses prédécesseurs? C’est que ces genres dépen- dent nécessairement du petit nombre de parties qui ont servi de division à la méthode, parties toujours saillantes, rarement générales ou sans exception, et par là peu constantes. 259. — [Un genre est un assemblage d’espèces qui se ressemblent dans le plus grand nombre de leurs parties, non pas dans toutes ni dans telles parties plutôt que dans telles autres( puis- qu’il y a des plantes qui manquent de telle partie tandis que telle autre partie manque dans d’autres, la racine, par exemple, manquant aux unes, la tige aux autres, les feuilles à d’autres, la fleur à d’autres, etc. ), mais tantôt dans telles parties, tantôt dans telles autres et en tel nombre, et cela suivant le genre et les mœurs propres à chaque famille. ] 260. —En admettant des espèces, il faudra nécessairement admettre que ce qui constitue l’espèce dans un règne, ne la constitue pas dans un autre; et que ce qui suffit pour la décider dans le règne minéral, ne suffit pas pour cela dans les deux autres règnes; car l’espèce est un terme abstrait, dont la chose n’existe qu’en considérant, dans certains êtres, la durée ou la succession des temps ; dans d’autres, la constance dans la génération ; dans les autres, le nombre ou la collection, la ressemblance, etc., des individus : c’est ainsi que la succession dans la multiplication constituera l’espèce dans les animaux constants qui ont les deux sexes, tandis qu’elle deviendra inutile dans les Aphrodites, qui n’ont pas de sexe, et dans lesquels elle est décidée par le nombre ou la ressemblance de figure, comme ces deux qualités les décident, avec la durée, dans les pierres, où la succession n’a pas lieu. 261. —La définition de l’espèce fondée sur quelques-unes de ces qualités n’est donc pas plus générale que les méthodes artificielles fondées sur une seule partie, dont nous avons y)arlé (p. 72); pour la rendre générale, il faut qu’elle s’étende sur toutes les qualités : ainsi elle consistera non-seulement dans la succession constante ou non, par génération ou non, mais encore dans la comparaison du nombre, de la ressemblance, de laduréedes individus; enfin dans toutes les autres qualités quelcomyues, telles que la grandeur, la couleur, etc.,](https://iiif.wellcomecollection.org/image/b24863890_0134.jp2/full/800%2C/0/default.jpg)