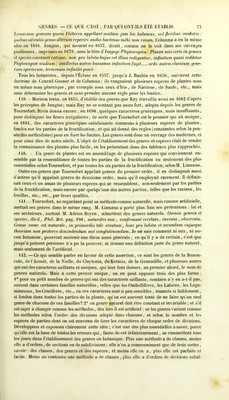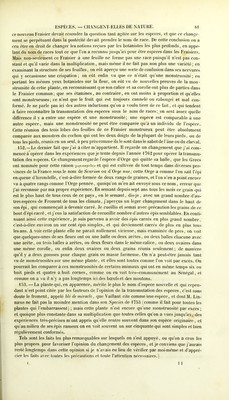Histoire de la botanique et plan des familles naturelles des plantes.
- Adanson, Michel, 1727-1806.
- Date:
- 1864
Licence: Public Domain Mark
Credit: Histoire de la botanique et plan des familles naturelles des plantes. Source: Wellcome Collection.
98/330 (page 78)
![ternes, qui vont quelquefois jusqu’au nombre de huit, savoir: 1“ classes ou parties; lé- gions; 3® phalanges; 4® centuries ; 5® cohortes; 6° ordres ou sections; 7° genres; 8® espèces. De sorte que chaque méthodiste, prenant pour principe que le caractère distinctif de tel ordre de division doit être tiré de telles ou telles parties, comme nous avons dit que Tourne- fort et M. Linnæus ont fait pour leurs classes, ordres, genres et espèces, il doit arriver que ceux qui ont un , deux, trois, quatre ou cinq subdivisions de plus que Tournefort et M. Lin- næus, appellent espèces ce que ces auteurs appelaient variétés, genres ce qu’ils appelaient espèces, ordres ce qu’ils appelaient genres, cohortes ce qu’ils appelaient ordres ou sec- tions, centuries ce qu’ils appelaient classes, et qu’ils fassent un choix et une combinaison toute différente des parties qui doivent leur servir pour caractériser leurs classes, légions, phalanges, etc. C’est surtout la différence du nombre et des espèces de parties qu’on choisit pour tirer le caractère de chaque ordre de division des méthodes, qui fait que les genres ne sont pas les mêmes dans deux méthodes différentes, et que les uns font des genres de cer- taines plantes dont d’autres font des espèces; le Pedicularis, le Rhinanthus, VEuphrasia, [’Odontiles, la Linaire, l’Antirrhinum, sont dans ce cas. C’est ainsi que les genres de Tourne- fort ont été différents de ceux de Rivin ; et plusieurs de ceux de M. Linnæus sont différents de ceux de Tournefort, et surtout dans les classes les plus reconnues naturelles, où les genres se confondent, pour ainsi dire , parce qu’ils faisaient tomber leurs caractères principaux sur des parties toutes différentes. Par exempte , la méthode de Tournefort, en considérant la sub- stance du fruit dans ses sections, a exigé qu’il fit trois genres distincts du Caprifolium, du Periclymenum et du Chamæcerasus; et celle de M. Linnæus, à cause de la division de ses ordres par les styles, a exigé qu’il ne fît de ces trois genres qu’un seul, qu’il appelle Loni- cera. Comment ranger la Valériane dans les systèmes sur la corolle ou sur les étamines , tant ces deux parties varient par la figure et par le nombre? MM. Albert Haller, Wachendorf et nombre d’autres botanistes ont de même changé plusieurs genres de M. Linnæus, toujours relativement à leur méthode, comme il arrivera aux genres de ces derniers, placés dans d’autres méthodes. 3“ [Enfin, comme plusieurs botanistes pensent que ces changements de genres dans les quatre méthodes citées ci-dessus, de MM. Tournefort, Linnæus, Haller, Wachendorf, peuvent provenir des dogmes particuliers à l’opinion dominante de chacun de ces auteurs , plutôt qu’à l’insuffisance de la partie qui sert de fondement à chacun de leurs systèmes ; j’ai voulu rendre ce fait plus palpable en lui donnant la plus grande extension : pour cela il fallait faire passer tous les deux mille genres de plantes connues par le plus grand nombre de systèmes simples qu’il serait possible d’exécuter, afin de reconnaître les change- ments que ces genres éprouvent en passant par chacun de ces systèmes. J’ai donc fait pas- ser ces genres par les soixante-cinq systèmes que j’ai compris sur toutes les parties et qualités des plantes, et je me suis convaincu à n’en pouvoir douter, par ces millions de millions de combinaisons, enfin par l’expérience la plus étendue et la plus variée qui ait peut-être jamais été faite en histoire naturelle, que presque toutes les espèces de plantes ont fait autant de genres en passant successivement par tous ces systèmes. ] 143.—Il est donc évident, par les faits, que les genres en général ne peuvent être tous na- turels dans aucune méthode artificielle ou arbitraire; et tous les axiomes qui ont été fondés pour l’établissement des genres naturels, sont sensiblement faux , parce que leurs auteurs n’ayant point une idée juste de la méthode naturelle , les rendaient relatifs aux principes abstractifs des méthodes artificielles. C’est ainsi que Tournefort et la plupart des modernes ont établi (jue les espèces qui se ressemblent par les parties de fructification sont de même genre, et que celles qui diffèrent par quelqu’une de ces parties, diffèrent aussi en genres; cependant Tournefort ne regarde pas ce principe comme absolu. M. Linnæus dit, Phil. Bot., p. 123 ; Si flores conveniuni, frucius autem differunt, cœteris paribus conjungenda sunt généra. M. Adrien Royen regarde comme un paradoxe insoutenable de séparer de genre deux plantes, parce que l’une aura un plus grand nombre de pétales que l’autre, fondé sur ce que l’on voit des corolles monopétales et polypétales dans la même espèce naturelle, par exemple dans le Saponaria concava Anglica. Ces axiomes et nombre d’autres semblables, qui sont vrais à l’égard de quelques plantes, ou même à l’égard de quelques familles de plantes, ne le sont jias pour les autres, comme cela sera prouvé dans la troisième partie. C’est pour cela que les botanistes, malgré tous leurs travaux , malgré la torture (lu’ils ont donnée à leur imagination ,](https://iiif.wellcomecollection.org/image/b24863890_0098.jp2/full/800%2C/0/default.jpg)