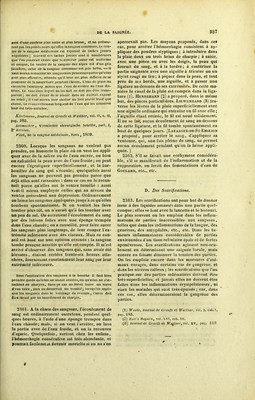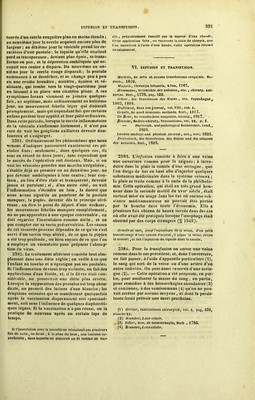Traité de chirurgie / par M.-J. Chélius, traduit de l'allemand,...par J. B. Pigné.
- Chelius, J. M. (Joseph Maximilian), 1794-1876.
- Date:
- 1836
Licence: Public Domain Mark
Credit: Traité de chirurgie / par M.-J. Chélius, traduit de l'allemand,...par J. B. Pigné. Source: Wellcome Collection.
Provider: This material has been provided by King’s College London. The original may be consulted at King’s College London.
619/714
![sont d'une couleur plus noire et. plus brune, et ne présen- tent pas les points noirs qu’offre la sangsue commune. Le ven- tre üe la sangsue médicinale est rayonné de taches jaunes régulières ; souvent ccs taches jaunes sont si nombreuses que l'on pourrait croire que la couleur jaune est uniforme et unique. Le ventre de la sangsue des Alpes est d’un gris jaunâtre, celui de la sangsue commune est gris lu tin. — Il vaut mieux recueillir les sangsuesau printemps parce qu’elles gont. plus affamées, attendu qu’il leur est plus difficile de se procurer de la nourriture pendant l’hiver. L’eau de pluie les conserve beaucoup mieux que l’eau de rivière ou l'eau dis- tillée. Le vase dans lequel on les met ne doit pas être trans- parent ; on doit éviter de le placer dans un endroit exposé au soleil ; il vaut mieux leur choisir un lieu plutôt froid que chaud. Le renouvellement fréquent de l’eau qui les conserve leur est très-nuisible. Kûnzmann, Journal de GracTe et Walther, vol. Il, c. II, pag. 263. Schmucker , vermisehte chirurgische Schrifte, part. I, 2' division. Kilet, De la sangsue médicinale. Paris , 1809. 2360. Lorsque les sangsues ne veulent pas prendre, on humecte la plaie où on veut les appli- quer avec de la salive ou de l’eau sucrée, ou bien on rafraîchit la peau avec de l’eau froide ; on peut encore l’égratigner superficiellement, et la bar- bouiller du sang qui s’écoule; quelquefois aussi les sangsues ne peuvent pas prendre parce que déjà elles sont rassasiées : dans ce cas on le recon- naît parce qu’elles ont le ventre tuméfié : aussi vaul-il mieux employer celles qui au niveau du ventre présentent une dépression. Ordinairement on laisse les sangsues appliquées jusqu’à ce quelles tombent spontanément. Si on voulait les faire tomber plus tôt, on n’aurait qu’à les toucher avec un peu de sel. Ou entretient l’écoulement du sang par des lotions faites avec une éponge trempée dans l’eau chaude; on a conseillé, pour faire sucer les sangsues plus longtemps, de leur couper l’ex- trémité inférieure avec des ciseaux. Mais ce con- seil est basé sur une opinion erronée : la sangsue tombe presque aussitôt qu’elle est coupée. 11 m’est arrivé d’observer des sangsues qui, sans avoir été blessées, étaient restées trente-six heures atta- chées, fournissant constamment leur sang par leur extrémité inférieure. Dans l'application des sangsues à la bouche il faut bien prendre garde qu’elles ne soient avalées, ou qu’elles ne s’at- tachent au pharynx. Dans ce cas on ferait boire un verre d’eau salée , puis ou donnerait un vomitif ; lorsqu’on appli- que les sangsues dans le voisinage dti rectum, l’anus doit être fermé par un bourdonne! de charpie. 2361. A la chute des sangsues, l’écoulement de sang est ordinairement entretenu, pendant quel- ques heures, à l'aide d'une éponge trempée dans 1 eau chaude; mais, si ou veut l'arrêter, on lave la partie avec de l’eau froide, et on la recouvre d’agaric. Quelquefois, surtout chez les enfans, l’hémorrhagie consécutive est très-abondante, et pourrait facilement devenir mortelle si on ne s’en apercevait pas. Les moyens proposés, dans ces cas, pour arrêter l’hémorrhagie consistent à ap- pliquer des poudres styptiques ; à introduire dans la plaie deux ou trois brins de charpie ; à saisir, avec une pince ou ayec les doigts, la peau qui fournit du sang, et à la tordre; à cautériser la partie saignante avec une aiguille à tricoter ou un stylet rougi au feu ; à piquer dans la peau, et tout près de ses bords, uue aiguille, et à passer une ligature au-dessous de ses extrémités. De cette ma- nière le canal de la plaie est compris dans la liga- ture (1). Hennemann (2) a proposé, dans le même but, des pinces particulières. Liewemjaud (3) .tra- verse les lèvres de la plaie superficiellement avec une aiguille ordinaire qui entraîne un fil avec elle ; l’aiguille étant retirée, le fil est noué solidement. Il ne se fait aucun écoulement de sang au-dessous de cette ligature, et le fil tombe spontanément au bout de quelques jours. [Lafakgue-de-St-Emilion a proposé, pour arrêter le sang, d’appliquer sa ventouse, qui, une fois pleine de sang, ne permet aucun écoulement pendant qu’on la laisse appli- quée. ] 2362. S’il se faisait une ecchymose considéra- ble, s’il se manifestait de l’inflammatiop et de la suppuration, on ferait des fomentations d’eau de Goulaud, etc., etc. D. Des Scarifications. 2363. Les scarifications ont pour but de donner issue à des liquides amassés dans une partie quel- conque ; elles se font avec la lancette et le bistouri. Le plus souvent on les emploie dans les inflam- mations de parties inaccessibles aux sangsues, telles que dans les inflammations de la langue, des gencives, des amygdales, etc., etc. Dans les tu- meurs inflammatoires considérables de parties environnées d'un tissu cellulaire épais et de fortes aponévroses. Les scarifications agissent non-seu- lement en déterminant une saignée locale, mais encore en faisant diminuer la tension des parties. On les emploie encore dans les morsures d’ani- maux enragés, dans certains cas de gangrène, et , dans les ulcères calleux ; lès scarifications que l’on pratique sur des parties œdématiées doivent être très-superficielles, et jamais elles ne doivent être faites dans les inflammations érysipélateuses , ni chez les malades qui sont très-épuisés ; car, dans ces cas, elles détermineraient la gangrène des parties. (1) Waete, Journal de Graefe et Walther, vol. I, eah.l, pag. Î86. (2) Rusl's Magazin, vol. \ VI, cali. III. (3) Journalde Graefe et Wqjther, vol. XV, pag. 119. #](https://iiif.wellcomecollection.org/image/b21306837_0633.jp2/full/800%2C/0/default.jpg)