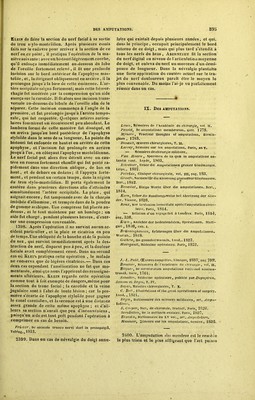Traité de chirurgie / par M.-J. Chélius, traduit de l'allemand,...par J. B. Pigné.
- Chelius, J. M. (Joseph Maximilian), 1794-1876.
- Date:
- 1836
Licence: Public Domain Mark
Credit: Traité de chirurgie / par M.-J. Chélius, traduit de l'allemand,...par J. B. Pigné. Source: Wellcome Collection.
Provider: This material has been provided by King’s College London. The original may be consulted at King’s College London.
625/714
![qu’on veut lui donner. — Le double cautère de Klein rend celte opération facile. Les points quel’ondoit éviter dans l'application du caulère actuel ou du moxa sopt le crâne (parce qu’il n’est recou- vert que de la peau et du péricrânc) ; du moins ori ne doit pas le maintenir appliqué pendant plus de deux secondes dans la crainte de voir son action se propager aux méninges ou au cerveau. On doit aussi éviler le trajet des apophyses épineuses, le dos du nez, les paupières, le niveau du la- rynx et de la trachée-artère , le sternum , les mamelles, la ligne blanche de l’abdomen, les parties où existent des ten- d6ns sous-cutanés , les organes^énitaux, les points des arli- culalions dont le peu d'épaisseurpourrait faire craindre l’ou- verture des cavités articulaires. Larrey, loco citato, pag. 6, pi. Il, f. 1 et 2. 2390. Lorsque le cautère actuel a été appliqué, on recouvre l’eschare d’une compresse sèche ou enduite de cérat simple ; si la douleur qui succède à cette opération est très-vive, on'fait des applica- tions anodines; le malade garde le repos , et il est, suivant les circonstances , soumis à un traitement narcotique ou antiphlogistique. Lorsque l’eschare se détache, on panse la plaie avec des onguens ca- pables de bâter la cicatrisation , ou d’entretenir la suppuration, suivant le but qu’on veut atteindre. Si la cautérisation a été pratiquée pour arrêter une hémorrhagie, il faut prendre garde que l’eschare ne se détache pas trop promptement [et surveiller attentivement le moment où elle doit se détacher, parce qu'alors l’hémorrhagie peut se reproduire]. 2391. Le moxa est un cylindre de colon contenu dans une bandelette de fil fortement serré, et fixé par quelques points de couture. Le moxa a envi- ron un pouce de hauteur, et son diamètre varie sui- vant le lieu où on doit l’appliquer et suivant aussi l’intensité que l’on veut donner à son action. Le colon ne doit pas être trop condensé, et la place où il doit être appliqué doit être parfaitement plane. Pour Oser le moxa pendant sa combustion on se sert d’un porte-moxa formé d'un anneau mé- tallique supporté par un trépied et un manche. Le pourtour du lieu où le moxa va être appliqué doit être recouvert d’une compresse mouillée afin de préserver la peau des parcelles euQammées du moxa qui peuvent s’en détacher. Lorsque le moxa est enflammé, on aelive sa combustion en soufflant sur lui à l’aide d’un tube; si au contraire on veut que son action soit leute, on le laisse brûler sans souffler. Une espèce de moxa qui est très-utile est celui que l’on fait avec du bois pourri phosphorescent, que l’on fait bien sécher ; on le pulvérise, et on en fait une pâte en le délayant dans de l’alcool , et en le roulant sur une machine ad hoc. On en fait un cylindre du diamètre d'une plume. Lorsque ce cylindre est sec, on le divise en morceaux de six lignes de hauteur. Ou recouvre l’une des faces de ces moxas d’un emplâtre digestif afin qu’il puisse coller sur la peau. Lorsque ces moxas sont allumés, ils brûlent sans qu'on soit obligé de souffler. La petitesse de leur diamètre permet de les appliquer sur toutes les parties et en très-grand nombre. (Larrey.) D’après Percy les meilleurs mfixas sont ceux qui sont faits avec la moelle du inurnesnl (helianihus annuus.) Voir : Journal de Gracfe et Wallher, vol. III, cah. III, pag. 491. [Dans ces derniers temps on a fait de nombreuses expé- riences pour savoir quelle était la meilleure préparation dont on pouvaifse servir pour la confection des moxas. Celle qui parait réunir le plus d’avantages est celle propo- sée par Jacobson. On prend une bande de papier non collé de la hauteur (l’un ponce environ ; on la trempe dans une so- lution concentrée de chroinale de potasse. Quand cette bande est sèche, on la roule sur elle-même de manière à former un cylindre creux du diamètre que l’on désire, mais dont les parois doivent être composées de trois, quatre ou cinq épaisseurs de papier, suivant l'a profondeur que l’or, veut donner à l’eschare. La base du moxa est traversée par une aiguille qui sert à le fixer à l’aide de pinces sur la par- tie où l’on veut appliquer; on allume le sommet, et il brûla sans qu’il soit besoin d’en activer la combustion. Si le moxa était très-large, il faudrait en placer un plus petit au cen- tre de l’espace qu'il circonscrit, et les faire brûler simulta- nément. — Depuis l’invention de Jacobson on a proposé di - verses substances , Lelles que le nitrate de potasse, l’acétate de plomb, etc., etc, ; mais parmi ces substances, les unes brûlent trop lentement, les autres trop rapidement , four- nissent une chaleur moins concentrée , et ne sauraient être préférées au r.bromate de potasse.] (Note du traducteur.) 2392. L’eschare formée par le moxa est recou- verte d'une compresse fine, et, si on veut favoriser sa chute pour établir un cautère, on la recouvre d’un ongnent digestif. Dans ce dernier cas on en- tretient la suppuration après la chute de l’eschare soit en touchant souvent la plaie avec du nitrate d’argent, ou bien en y plaçant un ou plusieurs pois, que l’on recouvre d’un emplâtre de diachylon et d'une bande assez serrée pour que ces corps étran- gers se creusent des cavités. 23y3. La différence d’action du moxa et du cau- tère actuel consiste en ce que le premier com- mence par déterminer une chaleur agréable qui augmente graduellement au point de causer une douleur des plus vives. Aussi son action s’étend- elle d’une ruaqière énergique sur les organes pro- fondément situés; aussi lui donue-t-on la préfé- rence sur le cautère actuel lorsqu'il s’agit de combattre des affections d’organes profonds. — Laksey pense que le. moxa, outre la quantité rela- tive de chaleur qu’il détermine, communique aussi aux organes voisins un principe actif qui se dé- veloppe parla combustion du coton. J. Bayle, Treatise on a moiiiûed application of moxa. Lond., 1826. Vallace, Physiological enquiry respecting tbe action of moxa. Dub., 1827. VIII. SECTION DES NERFS DANS LES NÉVRALGIES. Haightorii Annales de Schreger, vol. I, cah. Il, pag, 248](https://iiif.wellcomecollection.org/image/b21306837_0639.jp2/full/800%2C/0/default.jpg)