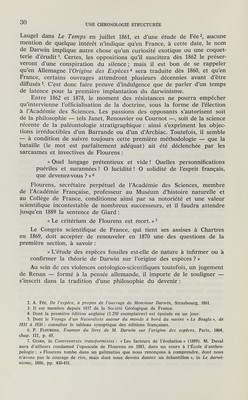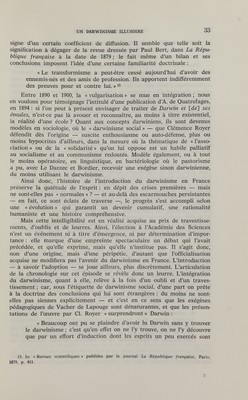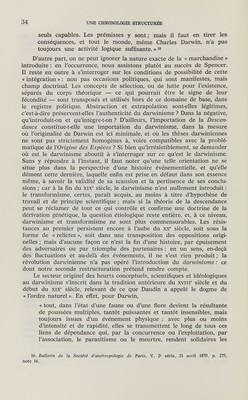L'introduction du darwinisme en France au XIXe siècle / par Yvette Conry.
- Yvette Conry
- Date:
- 1974
Licence: Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International (CC BY-NC-ND 4.0)
Credit: L'introduction du darwinisme en France au XIXe siècle / par Yvette Conry. Source: Wellcome Collection.
35/484 (page 33)
![UN DARWINISME ILLUSOIRE 33 signe d'un certain coefficient de diffusion. Il semble que telle soit la signification à dégager de la гедте dressée par Paul Bert, dans La Répu¬ blique française à la date de 1879 ; le fait même d'un bilan et ses conclusions imposent l'idée d'une certaine familiarité doctrinale : « Le transformisme a peut-être cessé aujourd'hui d'avoir des ermemis-nés et des amis de profession. Ils apportent indifféremment des preuves pour et contre lui. » Entre 1890 et 1900, la « vulgarisation » se mue en intégration ; nous en voulons pour témoignage l'intitulé d'ime publication d'A. de Quatrefages, en 1894 : si l'on peut à présent envisager de traiter de Darwin et [de] ses émules, n'est-ce pas là avouer et reconnaître, au moins à titre existentiel, la réalité d'une école ? Quant aux concepts darwiniens, ils sont devenus modèles en sociologie, où le « darwinisme social » — que Clémence Royer défendit dès l'origine — suscite enthousiasme ou auto-défense, plus ou moins hypocrites d'ailleurs, dans la mesure où la thématique de « l'asso¬ ciation » ou de la « solidarité » qu'on lui oppose est un habile palliatif au socialisme et au communisme redoutés. Modèle également, ou à tout le moins opératoire, en linguistique, en bactériologie où le pastorisme a pu, avec Le Dantec et Bordier, recevoir une exégèse sinon darwinierme, du moins utilisant le darwinisme. Ainsi donc, l'histoire de l'introduction du darwinisme en France préserve la quiétude de l'esprit : en dépit des crises premières — mais ne sont-elles pas « normales »? — et au-delà des escarmouches persistantes — en fait, ce sont éclats de traverse —, le progrès s'est accompli selon une « évolution » qui garantit un devenir cumulatif, une rationalité humaniste et une histoire compréhensive. Mais cette intelligibilité est en réalité acquise au prix de travestisse¬ ments, d'oublis et de leurres. Ainsi, l'élection à l'Académie des Sciences n'est un événement ni à titre d'émergence, ni par détermination d'impor¬ tance ; elle marque d'une empreinte spectaculaire un débat qui l'avait précédée, et qu'elle exprime, mais qu'elle n'institue pas. Il s'agit donc, non d'une origine, mais d'une péripétie, d'autant que l'officialisation acquise ne modifiera pas l'avenir du darwinisme en France. L'introduction — à savoir l'adoption — se joue ailleurs, plus discrètement. L'articulation de la chronologie sur cet épisode se révèle donc un leurre. L'intégration du darwinisme, quant à elle, relève à la fois d'un oubli et d'un traves¬ tissement ; car, sous l'étiquette de darwinisme social, d'une part on prête à la doctrine des conclusions qui lui sont étrangères : du moins ne sont- elles pas siermes explicitement — et c'est en ce sens que les exégèses pédagogiques de Vacher de Lapouge sont dénaturantes, et que les présen¬ tations de l'œuvre par Cl. Royer « surprendront » Darwin : « Beaucoup ont pu se plaindre d'avoir lu Darwin sans y trouver le darwinisme ; c'est qu'en effet on ne l'y trouve, on ne l'y découvre que par un effort d'induction dont les esprits vm peu exercés sont 15. In « Revues scientifiques » publiées par le journal La République française, Paris, 1879, p. 411. '2](https://iiif.wellcomecollection.org/image/b18022261_0036.JP2/full/800%2C/0/default.jpg)