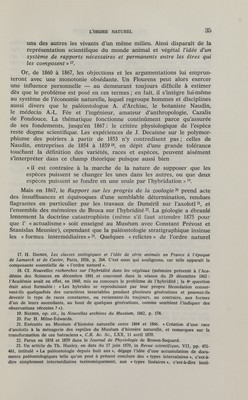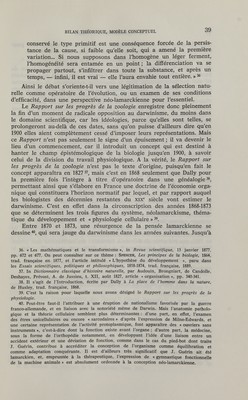L'introduction du darwinisme en France au XIXe siècle / par Yvette Conry.
- Yvette Conry
- Date:
- 1974
Licence: Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International (CC BY-NC-ND 4.0)
Credit: L'introduction du darwinisme en France au XIXe siècle / par Yvette Conry. Source: Wellcome Collection.
38/484 (page 36)
![36 UNE CHRONOLOGIE STRUCTURÉE subsistent néanmoins jusqu'en 1869, avec Agassiz et de Quatrefages, fidèles tous deux à la vision cuviériste, et, pour le second, monogéniste irréduc¬ tible. D'ailleurs — et l'histoire que nous découvrons et défendons est résolument pluraliste — cette métaphysique continuera à caractériser certaines disciplines ; ainsi en va-t-il de l'entomologie, avec les deux représentants notoires que sont Fabre et Blanchard : la rémanence s'explique par une certaine compréhension de l'instinct inhérente à cette région du savoir — H. Milne-Edwards, par exemple, s'opposera à Darwin sur ce problème, et il se référera, ce faisant, aux Souvenirs entomolo- giques 2'*. Persistance encore, mais à l'intérieur d'une science : en botanique, les « espèces » jordaniennes ^ seront une résurgence, miniaturisée en quelque sorte, du monde clos, statique et ajusté, de l'économie naturelle ; en zootechnie, A. Sanson maintiendra jusqu'en 1883 la mythologie de l'espèce archétype, tandis que les Vilmorin inclineront davantage à valoriser la sélection darwinienne. Parallèlement à cette thématique, à partir de 1865 (et jusqu'en 1890), l'anthropologie constitue le second territoire du débat pour le darwi¬ nisme : science jeune, à la fois prudente — le discrédit de la Naturphilo¬ sophie est encore proche — et indépendante, son objet la prépare à entendre l'Origine des Espèces, c'est-à-dire à lui prêter attention, à en discuter et user : « elle [la Société d'anthropologie] est venue à son heure, au moment où l'archéologie préhistorique, remontant jusqu'à l'époque de la pierre taillée, allait se mettre en continuité avec la paléontologie, et où la démonstration prochaine de l'antiquité de l'homme allait livrer un champ immense aux investigations anthropologiques ; au moment où l'existence des populations européennes autochtones, antérieures aux migrations asiatiques, était devenue certaine, et où la discussion des théories ethnogéniques était devenue nécessaire, au moment enfin où la première édition du livre de Ch. Darwin sur l'Origine des Espèces était déjà sous presse, où l'hypothèse hardie du transformisme, reparaissant sous une forme entièrement neuve, était sur le point de faire explosion dans l'histoire naturelle, et où l'anatomie comparée des singes anthropoïdes, complétée depuis peu par celle du gorille, laissait entrevoir aux transformistes la possi¬ bilité, ou plutôt l'espérance, d'étendre jusqu'à l'homme lui-même les applications de leur théorie » 26. tuant une ligne de descendance : « Je crois qu'aujourd'hui, grâce à un ensemble de docu¬ ments nouveaux émanés de diverses sources, il y a lieu de revenir sur la sévérité quelque peu romaine avec laquelle je parlais en 1862 d'une doctrine à laquelle j'aurais cependant été assez heureux de pouvoir reconnaître un fondement solide » (p. 452). 24. J.-H.-C. Fabre, Souvenirs entomoîogiques, publiés à partir de 1879. H. Milne-Edwards, Leçons sur la physiologie et l'anatomie comparées de l'homme et des animaux, t. XIII, 131« leçon. 25. A. Jordan, Les espèces végétales affines, Lyon, 1873. 26. P. Broca, « Histoire des progrès des études anthropologiques depuis la fondation de la Société ». Compte rendu décennal lu dans la séance solennelle du 8 juillet 1869, p. cxvii. Rappelons que les premiers travaux d'anthropologie préhistorique de Lartet datent de 1860, qu'en 1864 G. de Mortillet a fondé les Matériaux pour l'histoire de l'homme, et que la](https://iiif.wellcomecollection.org/image/b18022261_0039.JP2/full/800%2C/0/default.jpg)