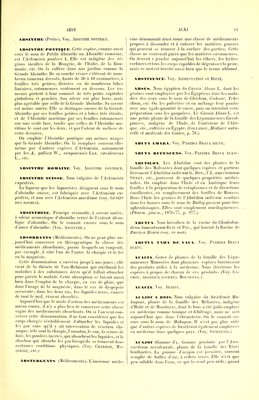Volume 1
Dictionnaire de thérapeutique, de matière médicale, de pharmacologie, de toxicologie et des eaux minérales / par Dujardin-Beaumetz ; avec la collab. de MM. Debierre[and others] ; Dr G. Bardet, secrétaire de la rédaction.
- Dujardin-Beaumetz, 1833-1895.
- Date:
- 1883-1895
Licence: Public Domain Mark
Credit: Dictionnaire de thérapeutique, de matière médicale, de pharmacologie, de toxicologie et des eaux minérales / par Dujardin-Beaumetz ; avec la collab. de MM. Debierre[and others] ; Dr G. Bardet, secrétaire de la rédaction. Source: Wellcome Collection.
Provider: This material has been provided by Royal College of Physicians, London. The original may be consulted at Royal College of Physicians, London.
28/908 (page 14)
![(le la France, le cliajjcau des cuves, dans les([uelles le jus du raisin l'eriiienle el (jui renlernie a la fois les nia- tiiu'es alliuminoïdes et l’alcool, on le vin, comme dans l(î centre et le nord de la Framie. >ous avons vu tiue le noir de |datine on certaines ma- tières oxydantes |)Ouvaient jouer le rôle du Mycodeniia uccli. De là deux [irocédés bien distincts (|ui iieuvent se n'sumer ainsi : 1 |irocédé d’Orléans modifié par Pas- teur, et procédé Dœbcreins tjuc nous n’indiquons ((ue pour mémoire, car il est jieu ou pas employé. Dans le [u'océdé d’Orléans, peiiectionuemenl de celui (|u’avail indiijué l!uerliave( 172(1),on verse dans des ton- neaux maintenus à25 ou 30 du vinaigre bouillant, juiis. Ions les buit jours, 10 à 12 litres de vin ayant déjà passé sur des copeaux de béirc où il a subi une|)remiére fer- mentalion. En (|uinze jours l’acétificatiou est complète. On soutire la moitié du contenu du tonneau, en rempla- çant par du vin nouveau le vinaigre ([u’on a enlevé. Dans le jirocédé Pasteur le li(|uide (jui doit suliir l’a- céliticalion est de l’eau additionnée de 2 jiour 100 d’al- cool, de 1 pour 100 de vinaigre, et d’une petite (|uantitéde pbospbates de potasse, de chaux el de magnésie destinés à l’alimentation du mycoderme. Le li([uide inlroduil dans des cuves jieu profondes, munies de couvercles, à l’aide de deux tubes de gutta-pereba allant juseju’au fond cl })0rcés latéralement de trous, est ensuite ense- mencé de mycoderme. La plantule se développe, recouvre bientôt toute la surface du li(|uide et l’acétification com- mence pour ne plus s’arrêter tant (|u’on lui fournit de l’alcool. Dans le cas contraire, son action se porte sur l’acide acéti(|ue formé el le convertit en acide carbonii(ue el en eau. On sôniirc le vinaigre et on recueille le my- coderme qui sert pour nue nouvelle opération. Ce pro- cédé jiermet d’opéi'er à une température plus basse, est plus rapide que celui d’Orléans (lOtl litres de li(|uide donnent cbaque jour G litres de vinaigre), et de plus il ne SC produit pas d’anguillules (|ui, sans cesse en lulli' avec le cryptogame ijiii leur enlève l’oxygène néces- saire à leur existence, le déchi([uétenl, le font lomlier au fond du tonneau et arrêtent ainsi l’acétilicalioii. Le vinaigre (lue l’on obtient en employant le vin pré- sente une coloration l'ouge s’il a été fait avec du vin rouge dont la matière colorante n’est pas détruite par la fermentation acéli(iue, et une couleur jaune clair si le vin blanc a été seul employé. Les vinaigres dilféreni un peu dans leur composition suivant les maliéi'es premières, .\insi celui qui provient du cidre, du poiré, du si’rop de fécule, de l’cau-de-vie, ne rcnfei'ine pas de bitartratc de potasse, ces li(|uides en étant dépourvus. Si le glucose a été employé, le vinaigre présentera une certaine pi'oporlion de sulfate de chaux (|uc renferme toujours b^ sirop |)réjiaré avec la fécule. Le malt, la bière laisseront dans le vinaigre du phosphate de chaux. Enfin l’alcool employé exclusi- vement donnera un liipiide dépomu'u de cet arôme (|ue l’on recberebe et qui est dû à la présence de l’éther acéti(|ue. Vinaujre dhlillc. En sonmellantle vinaigre à la dis- tillation dans des appareils inalla((uables par l’acide acétique, on obtient un produit doué d’une odeur aro- mati(|ue due surtout à la réaction ih' l’acide acéli(|ue sur l’alcool, après avoir en soin toutefois d’enlever l’o- (h'ur einpyrenmati(|ue (|u’il présente toujours, en expo- sant le li(|iiide distillé à un froid assez intense. Vinaiijrc radical. On désigne sous ce nom un acide i acétique concentré doué d’une odeur ai-omali(|ue particu- ! lièi'c. Pour l’obtenir on décompose par la chaleur l’acé- tate cuivriijue dans une cornue munie d’un réfrigérant. Les jiroduits de l’opération sont de l’eau, de l’acide acéti([ue, de l’acide carbonitjue, des produits empyreu- matiques et de l’acétone ou esjtrit pyro-acétiijue de Derosne C^II'^O, produit de décomposition de l’acide acé- ti([ue. 11 reste dans la cornue du cuivre divisé et du charbon. C’est l’acétone (|ui communi([ue au vinaigre radical son odeur étbérée. Le li(|uide obtimu est d’abord incolore, |uiis au con- tact de l’air il prend une teinte verte caractéristi([ue. C’est (|iie de l’acétate cuivrevix a passé à la distillation et (ju’il s’est converti peu à ]teu, au contact de l’air, en acétate cuivri(|ue vert. Lue nouvelle distillation donne un acide incolore qui renhu'ine environ 77 pour 10(1 d’a- cide pur. Acide pyroligneux. Ce nom lui avait été donné jadis quand on croyait (jue cet acide était un produit si»écial (le la décomposition ignée du bois. Ce n’est ([ue de l’a- cide acéti(jue étendu d’eau, souillé de matières empy- reumati([ues ou goudronneuses, dont l’usage en méde- cine est à jieu près nul, mais ([ui ni' peut être passé sous silence, car c’est lui qui fournit par une série d’o- pérations cbimi([ues tout l’acide acéti((ue employé dans les arts ou la tbérapeutifiue. Les bois de hêtre, de bouleau, de sapin, etc., débités en bûches de dimensions convenables, sont soumis à l’action de la chaleur dans des apjiareils distillatoires parfaitement clos, l^e produit obtenu est un mélang(' d’eau, de matières goudronneuses, d’acide acéli(|ue el d’alcool mélbyli(jue (es|)ril de bois), d’éthers divers, d’a- cétone, etc., etc. Un le rectilie par la distillation frac- tionnée. Les premières parties renfermant l’alcool mé- lbyli(iue, l’acétone, les éthers, sont mises à jiarl. Puis arrive un liipiidc coloré, l’acide acéli(|ue, et dans la cornue restent les matières goudronneuses. 100 kil. de bois donnent en moyenne de 38 à 18 kilo- grammes de li(|nide dans kujuel l’acide pyroligneux entre jiour 12 à 31 kilogrammes. En distillant nne deuxième fois cet acide, le li(iui(h' incolore ou peu coloré renferme 21 à 12 pour lOOd’acide acétique pur. C’est avec ce li([uide incolore, cet aci(h' ])yroligneux, (jue l’on jirépare l’acide acêli(|ue crislalli- sable. Acide acétique cristaUisable. L’acide pyroligneux est saturé par un lait de chaux ou par du carbonate de chaux; on laisse reposer, el on soutire le li(juide légè- rement trouble jiour le traiter jiar l’albumine (jni le clarilie conqdètenieni en entraînant à la surface les matières en susjiension. En évajiorant on obtient l’acétate de chaux (jne, ajirès dessiccation, on traite par l’acide sul- furi(|ue. Il s(' forme du sulfate de chaux et de l’acide acéli(jue libre (ju’on séjiare jiar la distillation, en ayant soin de ne jias jiousser la chaleur au jioini de faire jiasser l’acide sulfuri(|ue. Saturant cet acide acéti(|ne Jiar du carbonate sodi(ju(', on a de l’acétate de somh' (jiie l’on jieul obtenir également jiar double découqiosi- liou eu nn'llani en jirésencc l’acétate de chaux (M du sulfate de soude : (CUIW)=Ca -f iSo' iN’a» = -2CMUO=.\a + (So‘)» .Na^ Ca. L’acétate de soude, amené à siccité jiar évaporation de la solution, doit subir un léger couji de feu, suflisani pour carboniser les matières oi'gani(|nes (ju il renlernie toujours jiar suite de l’im|)urel(' de acide jiyroligneux.](https://iiif.wellcomecollection.org/image/b2490613x_0001_0028.jp2/full/800%2C/0/default.jpg)