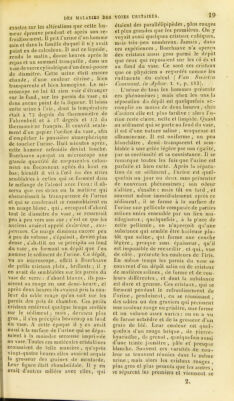Encyclopédie des sciences médicales, ou, Traité général, méthodique et complet des diverses branches de l'art de guérir / M. Bayle, rédacteur en chef. Traité des maladies des voies urinaires ; par Chopart ; avec des notes et des additions par P.-S. Ségalas.
- François Chopart
- Date:
- 1841
Licence: Public Domain Mark
Credit: Encyclopédie des sciences médicales, ou, Traité général, méthodique et complet des diverses branches de l'art de guérir / M. Bayle, rédacteur en chef. Traité des maladies des voies urinaires ; par Chopart ; avec des notes et des additions par P.-S. Ségalas. Source: Wellcome Collection.
Provider: This material has been provided by The Royal College of Surgeons of England. The original may be consulted at The Royal College of Surgeons of England.
28/506 (page 20)
![ramasser au fond du vase : les crîslaux pâles se séparent ensuite , niais, plus divisés , plus léf;crs et moins gros, ils s'arrêtent aisément sur les parois du vase ; ils y adhèrent fortement, et for- ment une incrustation diflicile à déla- clier. La matière colorante de ces cristaux, de ces sables, leur est-elle inhérente? Exposés à l'air, ils perdent leur couleur; ils se décolorent aussi par des lolions ré- pétées et deviennent grisâtres. Ceux de couleur de rttbis, de pierre-hyacinthe résistent davantage à leur décoloration. L'acide sulfurique les rend moins rou- ges, les fait pâlir et ne produit aucune effervescence. La solution de potasse dans Teau les dissout ; et si l'on y verse ensuite de l'acide sulfurique étendu d'eau , il se forme un précipité blanchâ- tre qui a de la consistance , ou dont lu substance est très-rapprochée. Comme la matière colorante de ces cristaux reste dans la dissolution de sulfate de potasse, elle ne leur est donc pas inhérente. Quelle est la nature de celte malière , nous l'ignorons.—La nature des cris- taux , des sables est la même que celle du calcul urinaire. Ces cristaux, qui sont les rudiments de celle espèce de calcul, sont formés entièrement, ou pour la plus grande partie, d'acide urique. Con- crets, durs, ils se broient moins aisément que les concrélions formées de phos- phate calcaire. Mis en poudre et délayés dans une petite quantité d'eau distillée, ils i-ougissent un peu le papier bleu. L'a- cide sulfurique n'y produit aucune ef- fervescence. La dissolution de potasse dans l'eau les dissout. L'alcool n'y ma- nifeste aucun effet, ne change pas même la couleur de ceux qui sont rouges. Mis sur un charbon allumé, ils donnent une fumée blanche et noircissent; s'ils étaient formés de phosphate calcaire, ils blanchi- raient. L'acide murialiqtie ne les dis- sout point ; mais cet acide oxygéné agis- sant sur eux, perd son odeur, enlève leur couleur, et les dissout en petite quantité : c'est une preuve que l'acide iirique de ces cristaux absorbe l'oxygène de l'acide muriatique et passe à un autre état. Toutes ces épreuves annoncent bien que les cristaux ou sables urinaires sont formés d'un acide particulier, qu'on nomme acide urique, lilhique ou lithia- Quelle est^ a nature de l'acide urujue? C'est un sel concret, cristallin, particu- lier, découvert par Schéele et Bergman, et dont l'exlsteiicc m'a été démontrée par le célèbre Fourcroy. Cet acide est composé d'azote, d'hydrogène, d'oxy- {?ènc et d'une grande ((uanlité de car- bone : on n'a pas encore déterminé la proportion de ces principes (l) ; on ne connaît pas non plus le lieu ni l'organe où cet .-icide se forme, ni la cause de sa séparation de l'urine dans les sujets cal- culeux : on sait seulement qu'il se trouve tout formé dans l'urine, qu'il tend tou- jours à s'en séparer, qu'il s'en sépare par le seul effet du refroidissement lors- qu'elle est sortie du corps , et qu'il se dépose sous la forme de cristaux , de sa- bles et même de graviers. — Les pro- priétés de l'acide urique sont : I» d'être peu soluble dans l'eau, et beaucoup moins dans celle qui est froide que dans l'eau chaude; 2 d'être dissoluble par l'acide nitrique, dont il absorbe une par- tie de l'oxygène ; 8° de s'unir aux terres, aux alcalis, aux oxydes métalliques. Lorsque l'acide urique est dissous par l'acide nitrique, il forme une masse rouge, déliquescente, dont il ne faut qu'une Irès-petile portion pour donner une cou- leur rose à une très-grande quantité d'eau. Celle dissolution tache la peau, les os et même le verre, comme la disso- lution nilreuse. Si l'acide urique est uni aux terres, aux alcalis, il forme des sels neutres particuliers que l'on nomme ura- tes de chaux, d'ammoniaque, de potasse, de soude; de même que l'union de l'a- cide phos]ihorique avec ces substances produit les sels connus sous les noms de phosphates calcaire, ammoniacal, etc., suivant la combinaison de l'acide phospho- rique avec la chaux , l'ammoniaque, etc. Mais l'acide urique préfère dans ses at- tractions les alcalis aux terres, et il cède ses bases, qui le mettent dans l'état de sel neutre, aux acides les plus faibles, aux acides végétaux et même à l'acide car- bonique ; ce qui est la cause de l'indis- solubilité de la pierre urinaire dans les carbonates alcalins, ou les alcalis satu- rés d'acide carbonique. Ce dernier ca- (1) Suiv.^nt M, Btirard de Montpellier, l'acide urique est composé, sur cent par- lies en poudre, de : Azote 59,1G Carbone. . • • 53,61 Oxygène. . . . l.S,89 Hydrogène. . . S.54 100,00 - • S.](https://iiif.wellcomecollection.org/image/b22272197_0028.jp2/full/800%2C/0/default.jpg)